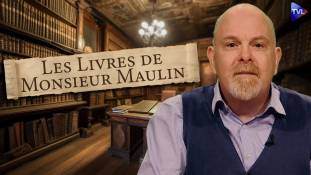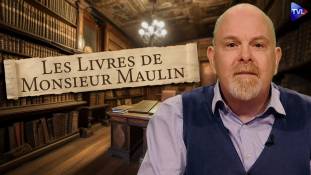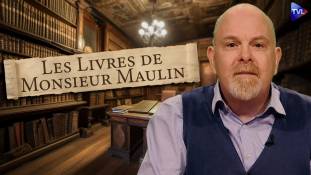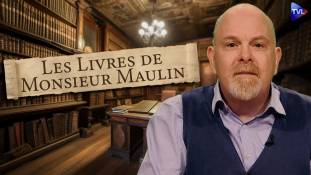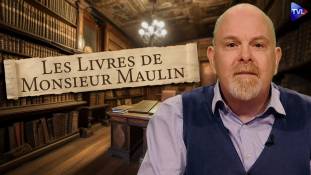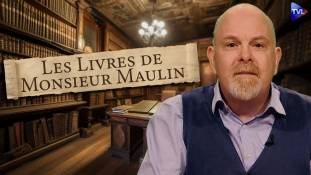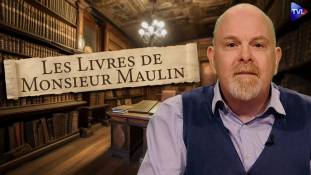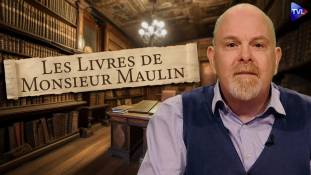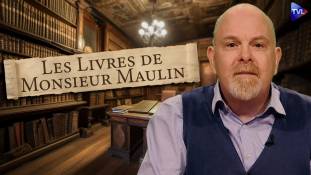Les Livres de Monsieur Maulin
Les Livres de Monsieur Maulin - Eloge du petit-bourgeois
Le Journal d’un homme sans importance, de George et Weedon Grossmith
Les frères George et Weedon Grossmith n’ont certainement pas réalisé l’ampleur de leur génie quand ils ont écrit Le Journal d’un homme sans importance : un journal imaginaire ayant donné vie à rien moins qu’un type humain, en l’occurrence le petit-bourgeois anglais de la fin de l’époque victorienne. Entré dans le catalogue de L’âge d’Homme en 2007, le roman a été réédité en 2019 par les Éditions Noir sur Blanc.
George Grossmith était pianiste et compositeur de chansons de music-hall ; son frère Weedon était dessinateur, acteur et auteur de vaudevilles ; en 1888, ils publiaient en feuilleton dans une revue satirique The Diary of a Nobody, repris en volume quatre ans plus tard avec des illustrations réalisées par Weedon.
Si le livre ne rencontra pas immédiatement le succès, il sera sans cesse réédité et deviendra culte au fil du temps, admiré aussi bien de George Orwell que d’Evelyn Waugh qui le tenait pour « le livre le plus drôle du monde ».
Drôle, ce journal l’est assurément, qui raconte la vie mesquine et sans intérêt de Charles Pooter, un employé modèle de la City, habitant avec sa femme Caroline dans une petite maison coquette de Holloway, dans la banlieue de Londres. Il passe la plupart de ses soirées en compagnie de ses amis Mr Cummings et Mr Gowing, il est très fier de ses blagues, se scandalise de la conduite de son fils Lupin, un bohème qui adopte une conduite excentrique (au point de porter un pantalon rayé le dimanche au lieu du frac traditionnel) et fréquente des acteurs de théâtre amateurs aux idées avancées.
Respectueux de la hiérarchie et de sa propre position sociale, Pooter est obséquieux avec les puissants et méprisant avec ses inférieurs. Invité à une soirée dansante par le Lord-maire de Londres, insigne honneur, il est humilié d’être salué familièrement par son quincailler. Pudique, d’une scrupuleuse honnêteté, son idéal de gentleman est constamment battu en brèche par les humiliations sociales qu’il subit et par la bêtise étriquée qui l’enferme dans ses certitudes et en fait un objet de moquerie universel.
Si l’on rit avec Pooter, et parfois contre lui, on est aussi touché par le personnage. Comme l’écrit son traducteur Gérard Joulié dans sa belle préface, ce petit employé sans qualité est avant tout un « innocent », c’est-à-dire, au sens propre, quelqu’un de non nuisible qui n’envisage les rapports humains que dans une forme susceptible d’en atténuer la violence. Son souci des apparences, ses principes corsetés, ne sont à ce titre que le pendant, on allait dire le prix à payer, d’une harmonie sociale à laquelle Pooter contribue largement.
Ce journal a fait rire aux éclats le XXe siècle ; on le lit pourtant aujourd’hui avec une pointe de nostalgie. A force de s’être moqué de ces petits-bourgeois qui prenaient la civilisation au sérieux, il se pourrait en effet que l’on soit arrivé à se « libérer » de toutes ces contraintes formelles qui pesaient sur la vie en société pour donner naissance à un monde du chacun pour soi et de la barbarie individualiste, un monde où l’on peut désormais se dévêtir dans les parcs au premier rayon de soleil et faire hurler sa musique sans souci des autres. Le balancier des manières est passée de la politesse un peu ridicule de Mr Pooter à un sans-gêne braillard et il n’est pas certain que nous y ayons beaucoup gagné…
Les livres de Monsieur Maulin - Anna, d’André Thérive, La Thébaïde
L’histoire littéraire est jalonnée d’écoles ou de courants, ou pour le moins de regroupements d’écrivains qui s’accordent sur une esthétique et la défendent. Le symbolisme, le naturalisme, les Hussards ou le Nouveau Roman sont quelques-uns de ces courants dont le souvenir est arrivé jusqu’à nous. D’autres ont été avalés par l’Histoire. C’est le cas du populisme qui, avant d’être l’offre politique que l’on connaît, a été un courant littéraire qui a irrigué le roman français durant l’entre-deux-guerres et nous a laissés quelques pépites.
On doit ce mouvement à deux écrivains : André Thérive, le « chef de file », un auteur aujourd’hui oublié mais qui jouissait de son vivant d’une reconnaissance considérable, et Léon Lemonnier, son « théoricien », oublié lui aussi, auteur d’un manifeste publié en 1929 et réédité en 2017 par une petite maison d’édition de qualité, La Thébaïde, qui inaugurait ainsi une collection intitulée « L’Esprit du peuple ».
Dans populisme il y a peuple, et c’est bien vers une représentation du peuple que Lemonnier voulait tirer le roman. Il s’agissait en somme de le replacer au cœur de la création romanesque et de « suivre l’humble vérité » préconisée par Maupassant. Si la littérature des années 1920 proclamait « la faillite du monde extérieur », une nouvelle séquence s’ouvrait à la fin de cette décennie. Le roman quittait « la littérature d’inquiétude » liée aux répercutions psychologiques de la guerre, littérature dans laquelle de « jeunes bourgeois […] rejetés dans leur vie plate après une période d’action brutale et de danger quotidien, cherchaient à se chatouiller l’âme pour se faire frissonner » comme le proclamait le manifeste. Fini l’introspection maladive et la littérature du bizarre, fussent-elle virtuose, Lemonnier plaidait pour une exploration du réel, c'est-à-dire, au fond, pour une littérature réaliste qui puisait dans la grande tradition du roman français. Parmi ces écrivains « populistes » ou « prolétariens » remarquables, il y a Eugène Dabit, Henry Poulaille, Marc Bernard, Louis Guilloux, Panaït Istrati, Pierre Mac Orlan ou Jean Meckert mais aussi Emmanuel Bove, Jean Prévost, Marcel Aymé, Jean Giono, et jusqu’au grand Céline dont Voyage au bout de la nuit, s’il brise tout cadre, n’en est pas moins clairement d’inspiration populiste. Mais il en est d’autres pour qui la postérité n’a pas été aussi généreuse, ceux que la Thébaïde a entrepris de rééditer à la suite du manifeste de Lemonnier : Louis Chaffurin, auteur de Pique-Puce, un « tableau des mœurs des tailleurs lyonnais » datant de 1928 ; la féministe Marcelle Capy qui dans Des Hommes passèrent… (1930) écrit la chronique d’un village du Sud-Ouest durant la guerre de 14-18 ; Jean Pallu qui dans L’Usine (1931) dresse un portrait pudique et pathétique de la condition morale des ouvriers à l’heure du taylorisme ; André Thérive, enfin, le chef de file du mouvement, et son magnifique roman intitulé Anna, qui date de 1932 et a été réédité en 2020.
Figure importante de la vie intellectuelle de l’entre-deux guerres, critique littéraire faisant autorité au Temps, romancier de première importance dans cette veine « populiste », intellectuel tenté dans sa jeunesse par Maurras, Roger Puthoste à l’état-civil a pourtant brutalement disparu des librairies au lendemain de sa mort en 1967. Anna est la première réédition post-mortem de l’auteur.
L’intrigue se déroule en 1900 et met en scène une jeune épouse de 21 ans, et son mari Edouard Chantiran, sergent-chef au 80e régiment d’infanterie basé à Tulle, puis à Limoges. Au retour d’une visite à son mari en manœuvre, ayant raté un train, la jeune femme va être aidée par un voyageur de commerce et passer la nuit dans une auberge de Treignac avec une bande de joyeux drilles qui la prennent pour la maîtresse du commerçant. Insignifiante aventure qui se termine par la mort accidentelle du fêtard et qui va prendre chez cette cousine de Mme Bovary des proportions inquiétantes : Anna se convainc en effet au fil des semaines qu’elle a réellement été la maîtresse de l’homme et s’invente une vie à frissonner, au risque de se perdre… Il serait criminel de dévoiler la suite, et notamment la seconde partie centrée sur le mari qui rejoint l’Algérie, et qui sera lui aussi victime de son imagination. Notons simplement que tout sonne juste dans ce roman très pessimiste, et notamment les différents tableaux de mœurs qui font revivre les petites gens de Corrèze et du Limousin en 1900, loin, très loin de « la Belle Epoque ».
Connexion
Afin d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter :