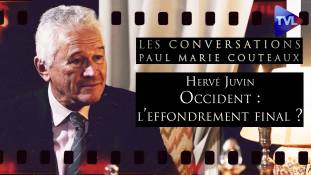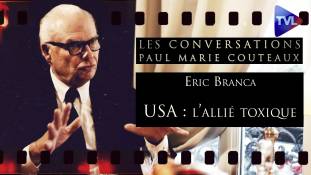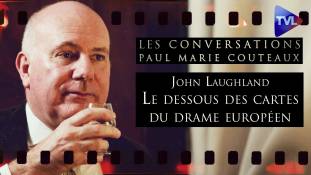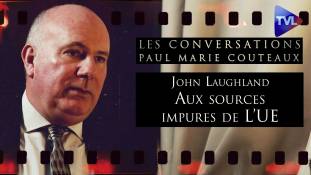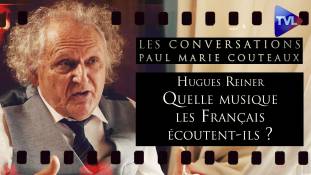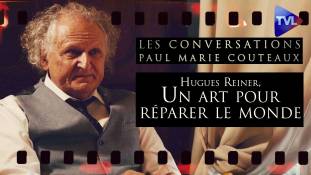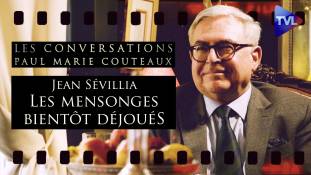Les Conversations
Les Conversations n°51 - Prince Jean de France : La question de la République est posée
Eté 2024 : à la faveur d’une dissolution improvisée, éclate l’un des plus lourds nuages qui assombrissent depuis des années le sort de la France, l’aporie nos institutions. Si la Constitution de la Vème République est solide, elle n’échappe pas à une contradiction majeure, qu’avait bien comprise son créateur : comment faire que le président de la République, clef de voute de notre architecture institutionnelle, soit à la fois président de tous les Français (remplissant la triple fonction d’assurer notre continuité historique, de garantir l'impartialité de l’Etat et d’arbitrer en cas de crise) et cependant élu au suffrage universel, c’est à dire par une partie de Français contre une autre ? Longtemps la question fut masquée par l'ombre gaullienne. Mais la tragédie se révèle avec les successeurs, chaque fois plus cruelle quand les Français se rendent compte que chacun des chefs d’Etat issu de l’élection est plus éloigné de ses missions fondamentales. Le pire étant atteint avec Emmanuel Macron, destructeur déclaré de notre continuité historique et si partial qu’il en devient minoritaire, son étiage tombant même, lors des européennes de juin, au dessous de 15%. Peu après, se fissurait le bien nommé front républicain, tandis que chacun peut observer que, constitué après des mois de crise, le gouvernement ne tient que par l’habile abstention du parti que ledit Front républicain visait précisément à exclure... Au fond, tout le drame de la France vient de ce que la tête de l’Etat est "débile", selon le mot qu’utilise ici, devant la caméra de TVL, Mgr le comte de Paris, Jean de France, à la faveur de deux conversations qu’Il nous a accordées avec son habituelle simplicité. Il est évident que, au regard des actuelles circonstances, cette rencontre, qui a pour but de permettre aux Français de Le connaître mieux, arrive à son heure.
Les Conversations de Paul-Marie Coûteaux n°78 avec Hervé Juvin (2ème partie) - "Qui mourra en premier : l’Occident ou le corps des occidentaux ?"
Attention, le contenu de cette émission est explosif. Voici l’une des Conversations les plus profondes depuis les origines de notre série voici bientôt dix ans.
Dans une première rencontre ("Mesurons-nous le basculement du monde ?"), Hervé Juvin a dévoilé le premier de ses moteurs intimes : un immense appétit du monde, qui l’a conduit à découvrir, aussi profondément qu’il est possible ("par la peau", dit-il), un grand nombre de pays - au point d’en conseiller quelquefois les élites politiques, ou commerciales, voire les gouvernements. Nous découvrons ici son itinéraire intellectuel : ses ouvrages publiés chez Gaillard avec la complicité constante de Pierre Nora et Marcel Gauchet, son passage au Parlement européen (Groupe RN), les axes majeurs de son mouvement politique, les "Localistes", d’une grande actualité en cette période d’élections municipales, pour en arriver à ce que sont à ses yeux les grandes questions du jour, toutes d’ordre écologique : la désertification de la France, le progressif empoisonnement des sols, la fin de l’agriculture artisanale qui fit l’humus de l’agriculture (et même de la culture française en son sens le plus large), la prise du pouvoir dans notre alimentation des consortiums allemands et états-uniens de l’agro-chimie, les atteintes au corps humain qui deviennent peu à peu irréversibles quand le corps de l’homme moderne, abandonné aux saccages de la restauration rapide devenue empoisonnement rapide, est littéralement gangrené par la chimie. Écoutons Juvin : l’avenir de l’Occidental est l’obésité, le diabète généralisé, l’infertilité et la dépopulation, les cancers précoces, les maladies dégénératives etc. Ecoutons aussi la réponse de cet ancien élu RN quand je lui pose cette question : que pense Marine Le Pen de tout cela ? Succulent… En revanche, quelles perspectives politiques s’ouvrent aux authentiques Conservateurs tels qu’a entrepris de les réunir le "Nouveau Conservateur" !
Il est vivement conseillé aux fidèles des Conversations de suivre celle-ci, qui ouvre des abysses d’inquiétudes - ou d’effroi. En un mot, Juvin nous pose une drôle de question : qui va disparaitre le plus vite, l’Occident politique et ses délires ou… le corps même des Occidentaux ?
Connexion
Afin d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter :